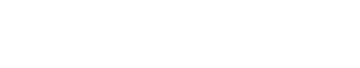Désolé, cette entrée de données est seulement disponible en English.
Galleries
La télémédecine se révèle efficace dans le traitement de la dépendance aux opiacés dans le Nord
Un éminent spécialiste de la toxicomanie est surpris des résultats d’une étude montrant que la télémédecine améliore les résultats du traitement des toxicomanies dans le Nord.
«On supposait que la télémédecine était une solution de rechange inférieure aux soins en personne, mais ce n’est pas le cas », affirme le Dr David Marsh, professeur à l’EMNO, chercheur principal en toxicomanie et membre d’un groupe de travail d’urgence sur les opiacés de la province.
«Nous avons commencé à étudier la télémédecine pour voir quels résultats engendrait son utilisation. Nous avons été très surpris d’apprendre que les patients en traitement de la toxicomanie qui avaient été vus par le biais de la télémédecine se portaient aussi bien, sinon mieux, que les patients vus en personne », explique le Dr Marsh.
Selon l’étude The effectiveness of telemedicine-delivered opioid agonist therapy in a supervised clinical setting, « les patients vus au moyen de la télémédecine présentaient un taux de rétention de 50 p. 100 au bout d’un an, tandis que ce taux était de 39 p. 100 chez les patients vus sur place ». L’étude a permis de conclure que la télémédecine « peut être une solution de rechange efficace à la prestation en personne du TAO [traitement par agonistes opioïdes], et qu’elle peut élargir l’accès aux soins dans les régions rurales, éloignées et urbaines »[1].
« Comme je vois mes patients fréquemment, souvent tous les mois pendant des années, je suis en mesure d’apprendre à les connaître assez bien par vidéoconférence », précise Dr Marsh.
Les systèmes de vidéoconférence et d’autres outils de soins virtuels constituent un moyen pratique de mettre en contact des patients qui, autrement, n’auraient peut-être pas accès à des cliniciens et à des spécialistes partout en Ontario, ou qui pourraient devoir parcourir de grandes distances pour les voir en personne.
Selon le document de recherche Clinical Telemedicine Utilization in Ontario over the Ontario Telemedicine Network, « la télémédecine est souvent utilisée pour fournir des services de santé mentale aux patients, en particulier à ceux qui résident dans des collectivités rurales et éloignées mal desservies ayant un accès limité aux services en personne. Praxia a signalé qu’en 2010-2011, 54 p. 100 de l’utilisation de la télémédecine au Canada était consacrée aux toxicomanies et à la santé mentale. Dans le cadre de notre étude, l’utilisation de la télémédecine était destinée dans une mesure de 62 p. 100 aux services de santé mentale et de toxicomanie. Ces chiffres laissent entendre que la télémédecine aide à compenser le manque de spécialistes médicaux dans les régions rurales et nordiques, ce qui permet de constater les avantages financiers et environnementaux associés à la réduction des déplacements des patients ou des fournisseurs ainsi que les avantages potentiels pour la santé d’un accès accru aux soins médicaux »[2].
Selon le Réseau Télémédecine Ontario (RTO), « en 2017-2018, plus de 30 nouveaux systèmes de télémédecine ont été distribués aux communautés autochtones avec plus de 120 systèmes actifs à travers la province. En 2018, le RTO a amélioré l’accès aux soins dans les postes de soins infirmiers éloignés des Premières nations de North Caribou Lake, Wunnumin Lake, Poplar Hill et Cat Lake »[3].
Selon Dr Marsh, la télémédecine offre un bon équilibre, en ce sens qu’elle permet aux patients d’avoir accès aux médecins plus facilement et plus près de leur domicile. « La prise en charge de la dépendance aux opiacés est structurée autour du traitement; elle fournit un soutien et un suivi qui aident les patients à améliorer leur santé mentale physique, à réduire leur consommation de drogues et à s’orienter vers des activités sociales plus positives », ajoute-t-il.
Ces interactions sociales fréquentes et mineures complètent les rendez-vous et les traitements de télémédecine, ce qui peut expliquer en partie l’amélioration des résultats.
«Je pense que pour certains patients, la vidéoconférence aide en fait parce que beaucoup de nos patients ont des problèmes de santé mentale importants, surtout des antécédents de traumatisme. La télémédecine établit une limite et un contexte dans lesquels les interactions se produisent. Je pense que cela aide le patient à se sentir en sécurité, surtout ceux qui ont eu des traumatismes dans le passé et qui ont de la difficulté à voir un médecin », explique le Dr Marsh.
Toutefois, il indique qu’il y a d’autres sujets que ses données de recherche n’ont pas encore permis d’aborder lorsqu’il s’agit de mesurer les stratégies de traitement de la dépendance aux opiacés dans le Nord, comme le besoin d’en apprendre davantage sur les taux de logements instables, l’itinérance, les liens avec des accusations criminelles, les interactions avec le système pénal et le contexte social. Il dit avoir bon espoir que d’autres outils seront mis au jour grâce aux recherches en cours.
« Nous avons un document qui fait actuellement l’objet d’un examen par les pairs et qui porte sur les résultats du système de santé de façon plus générale. Par exemple, lorsque les patients suivent un traitement à la méthadone et à la Suboxone, leur mortalité toutes causes confondues se trouve réduite de 55 p. 100. De plus, nous avons constaté une réduction importante du nombre d’admissions à l’hôpital et de visites à l’urgence avec traitement. Nous examinons aussi comment les services de santé mentale affectent le traitement. »
« La stigmatisation est certainement un problème majeur pour les personnes qui utilisent régulièrement des drogues. Elle les empêche d’obtenir des soins de santé et de se faire soigner. » Dr Marsh croit qu’en offrant des options de téléconférence, les patients auront accès à un plus grand nombre de médecins plus facilement et plus près de chez eux.
Sources :
[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871617302077
[2] https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/tmj.2015.0166 Clinical Telemedicine Utilization in Ontario over the Ontario Telemedicine Network, 2016.
[3] https://otn.ca/wp-content/uploads/2017/11/otn-annual-report.pdf
Médecine d’urgence rurale : Leçon tirée d’un collision frontale mortelle à Wawa
« Il faisait nuit noire sur la route. Aucun éclairage, sauf celui du véhicule en feu et les phares des voitures de police. Nous avons utilisé les phares de notre ambulance pour éclairer l’endroit, raconte Derek Blanchet, ambulancier spécialiste des soins primaires. Lui et son collègue, Zoltan Pinter, ont été les premiers intervenants à arriver sur le lieu de l’accident le dimanche 19 août 2018.
Ils intervenaient pour une collision frontale de deux véhicules sur la route 17, à 20 minutes au sud de Wawa, à 22 h 30. Le premier véhicule avait frappé un orignal puis le véhicule venant dans l’autre sens. Le résultat a été un incident avec atteintes massives (IAM) impliquant neuf personnes : deux enfants parmi les sept gravement blessés et deux morts.
« Nous avions un total de neuf patients, dont deux décédés sur place. Le sang de l’original rendait la route très glissante. La police avait extrait sept personnes des véhicules et les avait éloignés du véhicule en feu. En raison de l’épais brouillard, Ornge ne pouvait pas envoyer d’hélicoptère sur les lieux. »
De l’aide supplémentaire est arrivée une heure plus tard. L’équipe d’intervention d’urgence a pu orienter un patient à Sault Ste. Marie, un autre à London et le reste à l’Hôpital Lady Dunn à Wawa.
« Presque tous les fournisseurs de soins de santé qui étaient en ville ce soir-là sont venus apporter de l’assistance, et plusieurs ont ensuite été travailler le lendemain, indique le Dr Anjali Oberai, professeur agrégé à l’EMNO et directeur de la section de médecine familiale, en parlant de la longue nuit consacrée à traiter une grande variété de blessures graves. Ces types d’événements peuvent être stressants lorsqu’on travaille dans un endroit isolé, mais il est aussi réconfortant de voir tout le monde se mobiliser et travailler si bien en équipe. »
L’accident est survenu trop loin de tout centre de traitement des traumatismes de niveau 1, ce qui a présenté plusieurs défis pour l’équipe de traitement d’urgence des traumatismes.
« Nous avions cinq patients gravement malades dans notre petite salle d’urgence rurale. Les défis auxquels nous étions confrontés étaient principalement dus à notre milieu rural. Nous avions épuisé nos réserves de produits sanguins et nos ressources locales. Il peut être difficile de transférer des patients vers des centres de soins adaptés, ajoute le Dr Oberai. Le temps semblait ralentir pendant que nous attendions les transferts. »
L’équipe a recouru au système de soins intensifs virtuels (SIV) qui leur a permis de consulter un spécialiste situé à un autre endroit.
« Sur une note très positive, nos avons eu accès au médecin et au personnel des SIV qui sont restés avec nous (en ligne) jusqu’à ce que le dernier patient ait été transféré plus de 12 heures plus tard. Ce fut extrêmement utile d’avoir ce soutien à Wawa. »
Selon M. Blanchet, ce cas est un exemple réaliste de ce qui se passe dans n’importe quelle petite ville du Nord : « C’est une bonne étude de cas d’incident à atteintes multiples dans un petite ville et de la façon de traiter un volume important. Il ne faut pas grand-chose pour surcharger un petit hôpital comme le nôtre. Il pourrait être justifié de réévaluer le stock de produits sanguins et la façon de gérer la charge de patients ».
Blanchet pense que c’est l’occasion d’examiner ce cas et d’autres, et peut-être même d’effectuer des recherches, quand il s’agit des lignes directrices du ministère : « Le ministère devrait peut-être envisager des révisions pour les environnements ruraux où les ambulanciers peuvent être sur un lieu d’incident pendant une période prolongée et avoir besoin de davantage de ressources ».
Il fait également remarquer la possibilité d’offrir davantage de formation et de fournitures, de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de défibrillateurs, de bonbonnes d’air et de produits sanguins, d’offrir de la formation sur l’IV, de la formation annuelle sur les incidents à atteintes massives et la planification. De l’avis du Dr Oberai, il est certainement logique d’évaluer les produits sanguins disponibles et accessibles et les compétences en soins intensifs virtuels.
L’équipe multidisciplinaire a présenté ce cas d’incident à atteintes massives à la conférence sur les traumatismes pédiatriques à London au printemps. Elle était constituée du Dr Oberai, de la Dre Dannica Switzer, de Zoltan Pinter (services médicaux d’urgence) et de Sherri Egan (infirmière autorisée). « Une partie du message portait sur l’approche des soins en équipe » précise le Dr Oberai.
« Il a été très utile d’avoir une séance organisée de bilan après-coup. Le groupe de soins intensifs virtuels de Sudbury a pris les choses en main et incluait toutes les personnes de quatre hôpitaux qui sont entrées un jeu ce soir-là. On peut parfois oublier le fardeau émotionnel que des événements comme celui-ci peuvent avoir sur nos collègues » ajoute-t-il.
Soins intensifs virtuels (SIV)
Le 5 juillet 2019, Horizon Santé-Nord (HSN) a annoncé qu’au cours des cinq dernières années, l’équipe des SIV a été consultée pour 1 504 patients et a animé plus de 2 820 consultations virtuelles, ce qui a permis à plus de 620 patients de demeurer dans leur hôpital local.
Afin de fournir l’accès en permanence aux SIV dans le Nord de l’Ontario, une équipe de 37 médecins spécialistes des soins intensifs et de personnel infirmier formé spécialement, ainsi que 45 professionnels paramédicaux, y compris des inhalothérapeutes, des pharmaciens et des diététistes, sont disponibles à HSN pour des consultations jour et nuit. La vidéoconférence permet à l’équipe de communiquer avec d’autres unités de soins intensifs et services d’urgence de petits hôpitaux de la région.
Depuis mai 2014, de nouveaux partenariats de soins ont été établis entre HSN et 25 hôpitaux pour fournir aux patients de tout le Nord-Est l’accès à des services de médecins spécialistes des soins intensifs. L’intégration des sites côtiers de la Weeneebayko Area Health Authority est actuellement en cours avec la mise en œuvre des SIV à l’Hôpital d’Attawapiskat, l’Hôpital de Fort Albany, le poste de soins infirmiers de Kashechewan, et à l’automne, au Moosonee Health Centre.